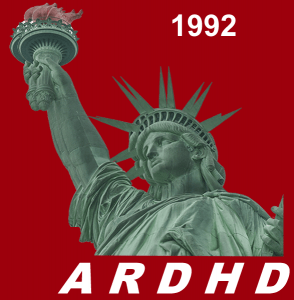28/04/05 (B295) RFI : Affaire Borrel, l’enquête impossible.
Dix ans après la mort de Bernard Borrel à Djibouti, la justice sait que ce juge français a bel et bien été assassiné, le 18 ou le 19 octobre 1995. Par qui ? Pourquoi ? Deux questions encore sans réponse. Seule certitude : en France, de nombreuses autorités se sont efforcées de freiner l’enquête ou d’en arrondir les angles saillants. Enquête de David Servenay.
L’« échec » des meilleurs policiers de France
De tous les enquêteurs s’étant penchés sur l’affaire Borrel, ceux de la Brigade criminelle ont été les plus convaincus à défendre la thèse du suicide du juge Bernard Borrel. Pourtant, dans l’écheveau des indices, des témoignages et des fausses pistes, il fallait envisager toutes les possibilités : suicide, meurtre ou assassinat ? Mobile privé ou raison d’Etat ? Vengeance professionnelle ou règlement de comptes personnels ?
En effet, tout semble confus, le 19 octobre 1995, lorsque des gendarmes français découvrent le corps sans vie de Bernard Borrel, magistrat français détaché par la coopération à Djibouti pour assister le ministre de la justice, Moumin Badon. Et surtout cette image spectaculaire d’un cadavre à moitié calciné retrouvé au pied d’une falaise à 80 kilomètres au nord-ouest de Djibouti, face à l’île du Diable.
En reprenant le dossier après les gendarmes et trois ans après les faits, les policiers pouvaient relever un vrai défi d’enquêteur ou accomplir un simple exercice judiciaire, passage obligé du quotidien judiciaire. Entre les deux, les enquêteurs de la Criminelle n’ont pas hésité longtemps. En témoigne, cette simple phrase. Une phrase ciselée, comme si son rédacteur avait soigneusement pesé chaque mot, chaque virgule et chaque qualificatif. Un modèle du genre, à la dernière page du rapport de synthèse rédigé par la section anti-terroriste de la Brigade criminelle, en novembre 1999, après un an et demi d’enquête sur le dossier :
« Sauf à envisager l’existence d’un vaste complot politico-judiciaire, impliquant dissimulation d’éléments d’enquête par les premiers intervenants, procès-verbaux volontairement erronés, examens médicaux orientés et conspiration généralisée du silence, l’hypothèse d’un assassinat ne peut à ce jour être sérieusement retenue. »
Un modèle du genre, car au fil des vérifications, les policiers ont balayé une à une les différentes pistes du dossier. Dans leur sabir, ils ont « fermé les portes » avec efficacité, mais parfois aussi avec une naïveté étonnante de la part de la prestigieuse brigade du 36 Quai des Orfèvres. Le rédacteur de cette sibylline conclusion a-t-il voulu montrer aux destinataires du rapport qu’il n’était pas dupe de la supercherie ? Laisser une trace aux historiens ? Un hameçon aux journalistes fouineurs ? En tout cas, les enquêteurs concluent, sans ambiguïté, au suicide.
Ce faux-semblant fait rire Elisabeth Borrel, la veuve de Bernard Borrel (elle-même juge des enfants depuis 23 ans) : « C’est assez amusant, parce que, quand on reprend chacun des termes -dissimulation d’éléments, PV erronés, examens médicaux orientés- je peux vous donner pour chacun d’entre eux des preuves dans le dossier de ce qu’ils existent. » Le rire s’arrête brusquement. «En fait, ces policiers n’ont jamais envisagé la thèse de l’assassinat et ils n’ont jamais enquêté dessus. » Et Elisabeth Borrel de se souvenir d’un autre procès-verbal surprenant, le premier PV de constatations rédigé par les gendarmes de la prévôté* où il est question « d’étayer la version du suicide ».
* Les gendarmes de la prévôté ont pour mission d’enquêter sur les crimes et délits commis ou subis par les militaires français en opération extérieure. Bernard Borrel étant un civil, ils n’avaient aucune compétence judiciaire pour enquêter sur cette affaire. Pourtant, ce sont deux gendarmes de la prévôté qui découvrent le corps de Bernard Borrel le 19 octobre 1995, à 7h30, en contrebas d’un parking au lieu-dit du Goubbeh, à 80 kilomètres de la capitale de Djibouti. Puis, c’est leur chef qui rédige le premier procès-verbal de constatations.
Si la France est aussi présente sur le territoire de cette ancienne colonie, indépendante depuis 1977, c’est que Djibouti abrite la plus importante base militaire française en Afrique : 2 800 hommes stationnés en permanence et une énorme station d’écoutes captant tout le Proche-Orient.
Les juges se succèdent, au détriment de l’enquête
Dix ans déjà que la veuve de Bernard Borrel lutte pour « savoir la vérité », pour comprendre, pour « transmettre des valeurs à ses enfants », précisent ses amies, un petit groupe de femmes rencontrées à son arrivée au tribunal d’instance de Toulouse à l’hiver 1995. Elisabeth Borrel a alors 37 ans, plus de mari et deux enfants, Louis-Alexandre, 8 ans et François-Xavier, 5 ans. Mais surtout, un énorme poids sur la conscience : le « suicide » de son mari, Bernard, 40 ans.
« Quand elle est arrivée, se souvient Josée Nicolas, c’était une femme cassée ». Josée fait partie du « village gaulois » -le surnom qu’elles ont choisi- le village de celles qui l’ont crûe immédiatement et soutenue, car au départ personne n’a vraiment envie d’écouter Elisabeth Borrel. Elle pleure, souvent. Elle évoque des noms inconnus, les Djiboutiens au pouvoir. Elle n’a plus personne avec qui échanger. Les coopérants français ont reçu l’ordre de ne plus lui parler.
Face à ce désespoir et aux doutes de cette catholique -pratiquante sans être bigote- la justice toulousaine ouvre une enquête pour « recherche des causes de la mort ». Myriam Viargues, juge d’instruction à l’excellente réputation, prend le dossier. Les experts traînent, l’autopsie n’a lieu que trois mois plus tard, en février 1996. Une commission rogatoire internationale est envoyée à Djibouti pour récupérer les premiers éléments de l’enquête. Elle ne reviendra jamais. Au bout d’un an, la juge a une conviction -ce n’est pas un suicide- mais pas de preuves. Le dossier est finalement « dépaysé », il passe entre les mains de deux magistrats parisiens, Marie-Paule Moracchini et Roger Le Loire. En janvier 1998, les deux juges démarrent leur enquête, convaincus eux aussi de la thèse de l’assassinat. Pourquoi ? Sans doute parce qu’ils ont lu le rapport des gendarmes toulousains :
« La thèse du suicide est en opposition avec des éléments dont certains sont inconnus ou inexpliqués. A ce stade, les aspects conjugaux ou extra-conjugaux paraissent pouvoir être écartés. Catholique pratiquant, jouissant d’une bonne santé, Bernard Borrel avait de grandes qualités humaines et professionnelles unanimement reconnues. ( ) le contexte socio-politico-économique de Djibouti pourrait ne pas être étranger à la mort violente de Bernard Borrel, si aucune autre voie n’est trouvée relevant de son entourage ou de ses relations. »
Pour vérifier ces éléments, les juges lancent leurs recherches en confiant l’enquête aux limiers de la Criminelle. Tout est repassé au peigne fin : témoins, comptes bancaires, constatations matérielles, examen des téléphones mobiles Les magistrats se rendent à Djibouti avec un expert, le docteur Dominique Lecomte, directrice de l’Institut médico-légal de Paris, mais sans les avocats de la partie civile.
Une erreur de procédure qui sera fatale au tandem, puisque les deux juges seront dessaisis à la suite de cette reconstitution. Plus grave : à l’automne 1999, alors qu’ils prévoient de boucler leur dossier par un non-lieu, les deux juges font la sourde oreille à un témoin-clé. A Bruxelles où il s’est réfugié, Mohamed Alhoumekhani s’est adressé aux magistrats français, sans résultat. Il se décide alors à parler, à visage découvert aux journalistes. En janvier 2000, cet ancien officier de la garde présidentielle raconte toute son histoire au Figaro. Deux mois plus tard, Marie-Paule Moracchini et Roger Le Loire viennent l’entendre à Bruxelles. Cette audition se déroule sans son avocat, mais en présence de deux officiers de police judiciaire belges. « Le climat n’était pas bon avec la juge, madame Moracchini était très nerveuse, dit le témoin, lorsque j’ai terminé, elle m’a dit de faire attention à la mafia corse et à la mafia libanaise et elle a ajouté « vous savez que votre président est très méchant et que ses gardes du corps aussi, et il paraît même qu’ils sont partis contre vous » ».
Cette adresse -menace, mise en garde ou simple conseil ?- sera confirmée par les policiers belges. Marie-Paule Moracchini n’a pas souhaité nous répondre, estimant que son «statut de magistrat [lui] interdit de parler à des journalistes d’une affaire dont [elle a] eu la charge en tant que juge d’instruction ». Elle dit préférer l’enceinte judiciaire pour défendre son point de vue. Elle a d’ailleurs intenté de nombreux procès en diffamation, contre des journalistes et contre les avocats d’Elisabeth Borrel. Aucune procédure n’est, à ce jour, définitivement terminée. Roger Le Loire, quant à lui, n’a pas répondu à nos relances, après nous avoir indiqué qu’il allait « réfléchir » à notre sollicitation.
Les services secrets français brouillent le jeu
Un nouveau juge d’instruction, Jean-Baptiste Parlos, sera le redresseur de la procédure. Après un nouveau transport à Djibouti, il décide d’exhumer le corps une seconde fois pour procéder à une nouvelle expertise confiée à un collège de quatre légistes. Une mesure décisive, car elle va permettre deux ans plus tard d’avoir, enfin, des preuves dans un dossier qui en manquait singulièrement. Puis il passe la main au juge Sophie Clément qui s’attaque à la dimension étatique de l’affaire. Le juge d’instruction a beau être, selon le mot attribué à Napoléon, «l’homme le plus puissant de France », ses prérogatives pèsent peu face à l’intérêt supérieur de l’Etat tel que le définit le secret-défense. En suivant à la lettre la procédure de déclassification des documents détenus par les services secrets français, la juge obtient une petite partie des rapports rédigés par les hommes de l’ombre. Rien pour les années 95 et 96, à l’époque des faits. Puis, pour les années 93-94 et la période s’étalant de septembre 1997 à mai 2003, quatre documents de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure / espionnage) et dix documents de la DPSD (Direction de la protection et de la sécurité de la défense / renseignement militaire). Des documents qui n’apportent pas grand chose à la compréhension des événements, laissant même parfois apparaître l’ironie bienveillante de leurs rédacteurs. Par exemple, une note rédigée par le chef de poste de Djibouti détaille les pérégrinations d’une équipe de journalistes de Canal + enquêtant sur place*.
* Sans intérêt autre que celui de savoir jusqu’où les enquêteurs de la chaîne de télévision iraient dans leurs recherches et leurs rencontres. Juge Borrel : révélations sur un suicide impossible, diffusé en décembre 2002, est la première enquête journalistique à révéler les mensonges de la version officielle.
Pour ce qui est de la production de la DGSE, le contenu des notes transmises par le ministère de la Défense tient en deux axes : premièrement, il faut plutôt retenir la thèse du suicide ; deuxièmement, cette affaire met en péril les relations franco-djiboutiennes. C’est l’essentiel de l’analyse fournie, à l’époque, au gouvernement Jospin. La DST (Direction de la surveillance du territoire / contre-espionnage) n’est pas en reste, puisque sur un classeur épais d’une dizaine de centimètres, seuls deux feuillets ont été déclassifiés.
L’embarras des espions français devient franchement perceptible à la lecture de leurs auditions face à Sophie Clément. Tous les hommes présents à l’époque des faits ont été interrogés. Ils ne disent pas toute la vérité, c’est leur métier. Ils ont aussi une obligation légale, puisque tous sont habilités « secret-défense » qui leur interdit formellement de dévoiler certaines informations. Plus gênant : ils n’ont pas du tout la même vision des faits. Et ce, dès le début. Le 21 octobre, deux jours après la découverte du corps de Bernard Borrel, ils se rassemblent pour leur traditionnelle réunion hebdomadaire d’échange d’informations. Au menu de la discussion : Bernard Borrel, suicide ou assassinat ? « Les gens connaissant monsieur Borrel n’imaginaient pas qu’il ait pu se suicider par le feu », dit l’un des hommes de la DPSD. Pourtant les principales autorités expatriées soutiennent mordicus la thèse du suicide, thèse annoncée dès le 19 octobre à 13h par un premier télégramme diplomatique signé du chef de la mission de coopération : « M. Borrel a mis fin à ses jours », écrit Jean-Jacques Moulines. En fait, cette réunion se passe mal, car les espions -DGSE et DPSD en tête- ne croient pas du tout à la version officielle donnée par les autorités françaises locales. M. A. le dit sans ambages à la juge Clément : « Je peux dire qu’il s’agit d’une affaire politique et que la réponse à cette question ne peut être que politique. C’est une réponse qui ne peut être faite que d’Etat à Etat. » On ne peut être plus explicite, le dossier Borrel gêne autant Djibouti que Paris.
Malaise persistant lorsque la juge auditionne un autre agent secret. Celui-ci n’a pas été en poste à Djibouti, mais il est sans doute l’un des premiers de la DGSE à avoir eu des doutes. Voici comment M. B. entame son récit : «Fin 1995, j’ai reçu, dans le cadre de mes activités professionnelles, des informations selon lesquelles Bernard Borrel serait mort, que cette mort serait due à un suicide fondé sur des tendances pédophiles ( ) ».
Parmi toutes les rumeurs qui ont couru sur les déviances supposées de Bernard Borrel (adultère, jeux, drogue) la pédophilie sera celle qui reviendra le plus fréquemment. Or, aucun élément du dossier judiciaire ne vient étayer un commencement de début de preuve en la matière. Deux témoins évoquent effectivement le cas d’un coopérant à l’homosexualité notoirement connue, à qui il est effectivement prêté des « tendances pédophiles ». Mais ces témoins sont formels, il ne s’agit pas de Bernard Borrel. Là encore, cette rumeur est la marque d’un savant travail de sape des « services ».
« En réalité, poursuit le témoin, il aurait été assassiné en raison d’informations compromettantes qu’il aurait recueillies dans le cadre de ses activités professionnelles à Djibouti. » L’espion ne va pas plus loin sur les faits, mais il précise : « cette source m’a donné des détails sur la légende construite autour de la mort de Bernard Borrel pour dissimuler l’assassinat et également pour que sa mort serve d’exemple. » La légende, dans le jargon de la « Piscine », c’est la couverture donnée à un agent ou à une cible pour justifier une version officielle crédible.
La « Piscine » est le surnom donné au siège de la DGSE, située boulevard Mortier à Paris, juste à côté de la piscine des Tourelles.
Question de la juge : « vous a-t-il dit si des membres du personnel politique djiboutien étaient impliqués dans cet assassinat ? Réponse de l’agent : Il m’a dit que des membres des services spéciaux étaient directement impliqués, au moins dans l’exécution de l’opération. » En se retranchant derrière le secret-défense et la protection des sources du service, ce témoin ne va pas plus loin dans l’explication de texte, mais il conclut son audition par ces phrases sibyllines : « Le sens de la DGSE, son seul sens, c’est la raison d’Etat. Elle travaille en dehors de la légalité nationale et internationale, avec des procédures clandestines pour obtenir des renseignements. Sa seule légitimité est la raison d’Etat. Il peut arriver, comme partout ailleurs, qu’il y ait des dérives personnelles ou des coalitions d’intérêt. Dans ce cas, son travail peut être dévoyé, voire dévergondé. Je pense que cela a dû aussi être le cas à propos du décès de Bernard Borrel. » Que faut-il comprendre à ce commentaire ? Les services spéciaux français ou certains de leurs membres ont-ils une responsabilité dans la mort d’un juge, le troisième* magistrat français assassiné depuis le début de la Ve République ? Auraient-ils reçu l’ordre, dix ans après les faits, de brouiller une nouvelle fois les pistes ? Pour protéger quel secret ? Ou quels intérêts ?
* Le 2 juillet 1975, le juge Renaud, l’un des fondateurs du Syndicat de la Magistrature, est abattu en pleine rue à Lyon par trois tueurs. Le 21 octobre 1981, Pierre Michel, juge à Marseille, est abattu par deux tueurs, alors qu’il enquête sur le réseau de la French Connection, un réseau de trafiquants d’héroïne. Bernard Borrel fut major de sa promotion de l’ENM, promotion « Juge Michel ».
David Servenay
Le 27/04/05